Mémoires du sergent Bourgogne (1812-1813)
Mémoires du sergent Bourgogne (1812-1813)
€ 0,99
Extrait :Ce fut au mois de mars 1812, lorsque nous étions à Almeida, en Portugal, à nous battre contre l’armée anglaise, commandée par Wellington, que nous reçûmes l’ordre de partir pour la Russie.
Nous traversâmes l’Espagne, où chaque jour de marche fut marqué par un combat, et quelquefois deux. Ce fut de cette manière que nous arrivâmes à Bayonne, première ville de France.
Partant de cette ville, nous prîmes la poste et nous arrivâmes à Paris où nous pensions nous reposer. Mais, après un séjour de quarante-huit heures, l’Empereur nous passa en revue, et jugeant que le repos était indigne de nous, nous fit faire demi-tour et marcher en colonnes, par pelotons, le long des boulevards, ensuite tourner à gauche dans la rue Saint-Martin, traverser la Villette, où nous trouvâmes plusieurs centaines de fiacres et autres voitures qui nous attendaient. L’on nous fit faire halte, ensuite monter quatre dans la même voiture et, fouette cocher ! jusqu’à Meaux, puis sur des chariots jusqu’au Rhin, en marchant jour et nuit.
Nous fîmes séjour à Mayence, puis nous passâmes le Rhin ; ensuite nous traversâmes à pied le grand-duché de Francfort, la Franconie, la Saxe, la Prusse, la Pologne. Nous passâmes la Vistule à Marienwerder, nous entrâmes en Poméranie, et, le 25 juin au matin, par un beau temps, non pas par un temps affreux, comme le dit M. de Ségur, nous traversâmes le Niémen sur plusieurs ponts de bateaux que l’on venait de jeter, et nous entrâmes en Lithuanie, première province de Russie.
Le lendemain, nous quittâmes notre première position et nous marchâmes jusqu’au 29, sans qu’il ne nous arrivât rien de remarquable ; mais, dans la nuit du 29 au 30, un bruit sourd se fit entendre : c’était le tonnerre qu’un vent furieux nous apportait. Des masses de nuées s’amoncelaient sur nos têtes et finirent par crever. Le tonnerre et le vent durèrent plus de deux heures. En quelques minutes, nos feux furent éteints ; les abris qui nous couvraient, enlevés ; nos faisceaux d’armes renversés. Nous étions tous perdus et ne sachant où nous diriger. Je courus me réfugier dans la direction d’un village où était logé le quartier général. Je n’avais, pour me guider, que la lueur des éclairs. Tout à coup, à la lueur d’un éclair, je crois apercevoir un chemin, mais c’était un canal qui conduisait à un moulin que les pluies avaient enflé, et dont les eaux étaient au niveau du sol. Pensant marcher sur quelque chose de solide, je m’enfonce et disparais. Mais, revenu au-dessus de l’eau, je gagne l’autre bord à la nage. Enfin, j’arrive au village, j’entre dans la première maison que je rencontre et où je trouve la première chambre occupée par une vingtaine d’hommes, officiers et domestiques, endormis. Je gagne le mieux possible un banc qui était placé autour d’un grand poêle bien chaud, je me déshabille, je m’empresse de tordre ma chemise et mes habits, pour en faire sortir l’eau, et je m’accroupis sur le banc, en attendant que tout soit sec ; au jour, je m’arrange le mieux possible, et je sors de la maison pour aller chercher mes armes et mon sac, que je retrouve dans la boue.
Le lendemain 30, il fit un beau soleil qui sécha tout, et, le même jour, nous arrivâmes à Wilna, capitale de la Lithuanie, où l’Empereur était arrivé, depuis la veille, avec une partie de la Garde.
Pendant le temps que nous y restâmes, je reçus une lettre de ma mère, qui en contenait une autre à l’adresse de M. Constant, premier valet de chambre de l’Empereur, qui était de Péruwelz, Belgique. Cette lettre était de sa mère, avec qui la mienne était en connaissance. Je fus où était logé l’Empereur pour la lui remettre, mais je ne rencontrai que Roustan, le mameluck de l’Empereur, qui me dit que M. Constant venait de sortir avec Sa Majesté. Il m’engagea à attendre son retour, mais je ne le pouvais pas, j’étais de service. Je lui donnai la lettre pour la remettre à son adresse, et je me promis de revenir voir M. Constant. Mais le lendemain, 16 juillet, nous partîmes de cette ville.
Extrait :Ce fut au mois de mars 1812, lorsque nous étions à Almeida, en Portugal, à nous battre contre l’armée anglaise, commandée par Wellington, que nous reçûmes l’ordre de partir pour la Russie.
Nous traversâmes l’Espagne, où chaque jour de marche fut marqué par un combat, et quelquefois deux. Ce fut de cette manière que nous arrivâmes à Bayonne, première ville de France.
Partant de cette ville, nous prîmes la poste et nous arrivâmes à Paris où nous pensions nous reposer. Mais, après un séjour de quarante-huit heures, l’Empereur nous passa en revue, et jugeant que le repos était indigne de nous, nous fit faire demi-tour et marcher en colonnes, par pelotons, le long des boulevards, ensuite tourner à gauche dans la rue Saint-Martin, traverser la Villette, où nous trouvâmes plusieurs centaines de fiacres et autres voitures qui nous attendaient. L’on nous fit faire halte, ensuite monter quatre dans la même voiture et, fouette cocher ! jusqu’à Meaux, puis sur des chariots jusqu’au Rhin, en marchant jour et nuit.
Nous fîmes séjour à Mayence, puis nous passâmes le Rhin ; ensuite nous traversâmes à pied le grand-duché de Francfort, la Franconie, la Saxe, la Prusse, la Pologne. Nous passâmes la Vistule à Marienwerder, nous entrâmes en Poméranie, et, le 25 juin au matin, par un beau temps, non pas par un temps affreux, comme le dit M. de Ségur, nous traversâmes le Niémen sur plusieurs ponts de bateaux que l’on venait de jeter, et nous entrâmes en Lithuanie, première province de Russie.
Le lendemain, nous quittâmes notre première position et nous marchâmes jusqu’au 29, sans qu’il ne nous arrivât rien de remarquable ; mais, dans la nuit du 29 au 30, un bruit sourd se fit entendre : c’était le tonnerre qu’un vent furieux nous apportait. Des masses de nuées s’amoncelaient sur nos têtes et finirent par crever. Le tonnerre et le vent durèrent plus de deux heures. En quelques minutes, nos feux furent éteints ; les abris qui nous couvraient, enlevés ; nos faisceaux d’armes renversés. Nous étions tous perdus et ne sachant où nous diriger. Je courus me réfugier dans la direction d’un village où était logé le quartier général. Je n’avais, pour me guider, que la lueur des éclairs. Tout à coup, à la lueur d’un éclair, je crois apercevoir un chemin, mais c’était un canal qui conduisait à un moulin que les pluies avaient enflé, et dont les eaux étaient au niveau du sol. Pensant marcher sur quelque chose de solide, je m’enfonce et disparais. Mais, revenu au-dessus de l’eau, je gagne l’autre bord à la nage. Enfin, j’arrive au village, j’entre dans la première maison que je rencontre et où je trouve la première chambre occupée par une vingtaine d’hommes, officiers et domestiques, endormis. Je gagne le mieux possible un banc qui était placé autour d’un grand poêle bien chaud, je me déshabille, je m’empresse de tordre ma chemise et mes habits, pour en faire sortir l’eau, et je m’accroupis sur le banc, en attendant que tout soit sec ; au jour, je m’arrange le mieux possible, et je sors de la maison pour aller chercher mes armes et mon sac, que je retrouve dans la boue.
Le lendemain 30, il fit un beau soleil qui sécha tout, et, le même jour, nous arrivâmes à Wilna, capitale de la Lithuanie, où l’Empereur était arrivé, depuis la veille, avec une partie de la Garde.
Pendant le temps que nous y restâmes, je reçus une lettre de ma mère, qui en contenait une autre à l’adresse de M. Constant, premier valet de chambre de l’Empereur, qui était de Péruwelz, Belgique. Cette lettre était de sa mère, avec qui la mienne était en connaissance. Je fus où était logé l’Empereur pour la lui remettre, mais je ne rencontrai que Roustan, le mameluck de l’Empereur, qui me dit que M. Constant venait de sortir avec Sa Majesté. Il m’engagea à attendre son retour, mais je ne le pouvais pas, j’étais de service. Je lui donnai la lettre pour la remettre à son adresse, et je me promis de revenir voir M. Constant. Mais le lendemain, 16 juillet, nous partîmes de cette ville.
| Prijs | Verzendkosten | Totaal | |
|---|---|---|---|
€ 0,99 | € 0,00 | € 0,99 |
Alternatieve producten
© 2016 - 2024 aanbiedingchecker
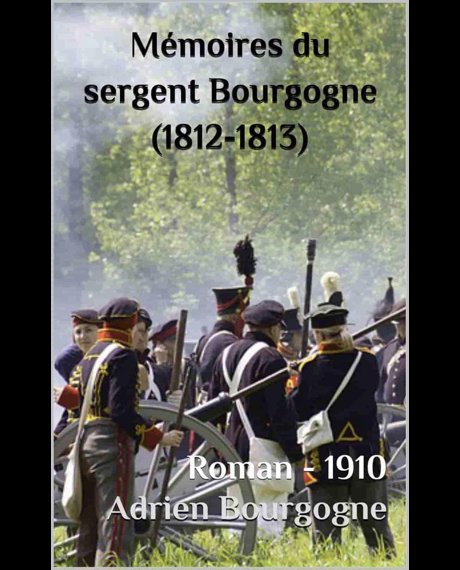

/backgroundcolor(255,255,255)/jpg(90)/fetch/https://media.s-bol.com/JGqxAPRKK5J/930x1200.jpg)
/backgroundcolor(255,255,255)/jpg(90)/fetch/https://media.s-bol.com/Zl60Lm4jo0v/921x1200.jpg)